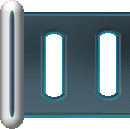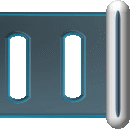|
1. Ne paniquez pas 2. Vérifier si le cétacé est toujours vivant. Dans la plupart des cas, l'opération est aisée: ou bien l'animal bouge encore ou il commence à se décomposer. Toutefois, si l'animal ne remue plus, mais paraît en bonne santé, son approche doit s'effectuer de face. A ce stade, évitez la queue qui pourrait brusquement asséner de sérieux coups. Tentez de percevoir une quelconque respiration; cela peut prendre une dizaine de minutes ou plus encore, selon l'espèce. Entre temps, regardez les yeux, sans toute fois les toucher. Si ces derniers sont ouverts et si l'animal est vivant, ils devraient suivre les mouvements d'un doigt lentement déplacé dans leur champ de vision. Prenez cependant garde que le cétacé ne roule pas sur vous ou qu'il ne soit pas poussé sur vous par les vagues. 3.Notez soigneusement la position et signalez aussitôt l'échouage à l'organisme local chargé d'enregistrer ce genre d'incident ,si vous êtes certain de la mort de l'animal. Cet organisme prendra en main la suite des opérations. En cas de doute, appelez la police, les gardes côtes, les membres du personnel d'un musée ou même l'office de tourisme local. Dans de nombreuses régions, la loi interdit d'endommager tout animal ou d'en extraire quelque fragment que ce soit sans l'autorisation préalable. Les souvenirs de l'évènement doivent donc se réduire à des photographies ou à des dessins. Toutefois s'il n'y a aucun moyen de contacter les autorités compétentes, si la marée est sur le point d'emporter le cadavre ou si les circonstances font que personne n'arrivera à temps pour faire les observations nécessaires, débrouillez vous pour réaliser un enregistrement aussi complet et aussi précis que possible. Les photographies sont idéales: elles fournissent suffisamment d'informations pour identifier l'animal et le site de l'incident. Les clichés ne doivent pas être "artistiques". Judicieusement répartis, ils doivent inclure un quelque étalon de mesure (une personne , un objet ou même une chaussure) de taille connue. Deux photos seront prises perpendiculairement à l'animal (une pour chaque flancs), révélant toute la longueur de son corps. Photographiez ensuite la tête, l'aileron dorsal(s'il en existe un), la queue et les nageoires pectorales. Tentez de réaliser des gros plans de marques éventuelles, des cicatrices ou des parasites. N'oubliez pas d'inclure dans l'un ou l'autre de vos clichez des caractéristiques du paysage local de manière à identifier avec précision le site de l'échouage. Si vous n'avez pas d'appareil photographie sous la main, notez les mêmes renseignements sur un carnet ou sur une feuille de papier, en vous servant d'un quelconque étalon de mesure(des pas ou un morceau de cordes par exemple). Faites une esquisse du cadavre et reportez-y vos mesures. Si possibles, enterrez le cadavre(la tête, au moins) bien au-dessus de la laisse de haute mer et notez sa position exacte par rapport à des point de repères répartis dans le paysage. Attention: les "stèles" faites de bâtons ou de pierres fascinent apparemment les promeneurs, qui s'empressent de les détruire ou de les déplacer. Si l'enfouissement se révèle impossible, le prélèvement de la tête sera très utile, mais la mâchoire inférieure (ou l'un de ses maxillaires), une dent ou un fanon suffisent en général. Il est possible de définir le sexe de l'animal si le ventre de ce dernier est apparent _ la fente urogénitale du mâle est à quelque distance de l'ouverture anale; celle de la femelle paraît prolonger l'ouverture de l'anus. En cas de doute , réalisez une esquisse. Signalez d'urgence votre découverte aux autorités compétentes et laissez leur vos coordonnées pour le cas où elles désireraient des informations complémentaires. 4. Si l'animal est vivant ou si vous n'êtes pas certain de sa mort, cherchez de l'aide aussi rapidement que possible, après avoir soigneusement pris note de la taille, de l'état et de la position de la victime. Les difficultés de renflouage croissent avec la durée de l'échouement. Si vous devez quitter le cétacé pour quérir quelque assistance, faites tout ce que vous pouvez pour alléger son martyre. Ainsi, redressez le et calez-le de façon à ce que son évent ne se remplisse jamais d'eau; débarrassez les environs des objets ou des pierres qui risqueraient d'endommager sa peau; tentez d'envelopper le corps dans une couverture humide et fraîche( des serviettes de bain mouillées ou des algues, par exemples). Faites attention à ne pas bloquer l'évent, habituellement situé au dessus du crâne : l'introduction d'eau dans ce conduit provoquerait la noyade de l'animal; celle de sable endommagerait les poumons. Ne laissez rien pénétrer dans les yeux. En attendant les secours, maintenez l'animal au frais, calme et rassuré. Les cétacés sont bâtis pour une vie aquatique et leur température corporelle s'élève très rapidement sur terre, même si le temps n'est pas au chaud. Leur système de régulation thermique est situé dans les nageoires: ces structures doivent donc être rafraîchies en priorité. Laisser-les tremper dans de l'eau remplissant des trous que vous aurez creusés dans le sable. La peau des cétacés est particulièrement fragile et se dessèche très rapidement à l'air: toute son étendue doit être constamment humidifiée. Déranger, l'animal risque de rouler sur lui même et de se blesser _ ou de blesser les personnes qu'il trouve sur son chemin. Tous les "sauveteurs" doivent donc impérativement se comporter calmement, en essayant d'apaiser autant que possible l'objet de leurs soins. Ils ont tout intérêt à s'organiser en équipes coordonnées par un "maître de plage". Par exemple, un groupe pourrait s'occuper du rafraîchissement du cétacés; un autre tiendrait à distance respectable les spectateurs ; d'autres encore seraient affectés à l'enregistrement des mesures corporelles ou à l'apaisement de la victime. Les équipes devraient être régulièrement relevées, pour éviter la fatigue des sauveteurs et pour permettre à d'autres bénévoles de contribuer au renflouage. Le " maître de plage" se retirera à l'arrivée des experts. Si ces derniers sont en routes, résistez à la tentation de remettre l'animal à l'eau _ vous pourriez le blesser sans le vouloir. S'il est clair que vous êtes livré à vous même, il vous faut soigneusement évaluer la situation : (a) Si vous êtes seul, sans espoir de recevoir de l'aide et si l'animal est trop imposant pour être aisément soulevé, il n'est rien que vous puissiez faire, sauf réduire l'inconfort du cétacé; notez un maximum d'information et remettez-les le plus vite possible aux autorités compétentes. Au moins, ces données ne seront pas perdues. (b) Si la taille de l’animal dépasse les capacités des moyens disponibles, encore une fois résignez-vous à réduire les souffrances du cétacé, à recueillir le maximum d’informations le concernant et à transmettre celle-ci sans délai. (c) Si les moyens disponibles vous paraissent suffisants pour soulever l’animal et si l’état de la mer n’offre aucun danger pour les sauveteurs, préparez-vous alors à entrer en action. Répartissez les tâches de chacun, renseignez-vous sur les heures des marées pour choisir le moment propice et assurez- vous qu’il reste assez de temps pour terminer le travail à la lumière du jour. Si la température ambiante est faible il est parfois préférable de remettre l’opération au lendemain.(d) Avant de renflouer l’animal, photographiez-le ou notez-en les caractéristiques de la même manière que vous auriez opéré avec un cétacé mort. Notez les marques particulières qui permettraient de l’identifier à nouveau _ en mer ou sur une plage. (e) Le renflouage exige un maximum de précautions. Les nageoires ne peuvent être tirées ni poussées : fragiles, ces structures se disloquent aisément. La peau est également délicate : il faut donc utiliser une espèce de ventrière capable de supporter la masse du corps sans déchirer l’épiderme. L’animal sera soulevé et déposé sur cette structure, à moins que cette dernière ne soit doucement glissé sous le corps. Le cétacé sera alors transporté à l’eau, jusqu’à une profondeur suffisante pour supporter son propre poids. La ventrière ne sera détachée que lorsque l’animal sera manifestement capable de se déplacer par lui-même. Veillez que celui-ci ne bascule pas sur le flanc et que son évent ne se remplisse pas d’eau. Le cétacé peut faire d’une certaine raideur après son séjour sur la plage ; il a besoin d’être soutenu quelque temps dans l’eau (des roches arrondies à lui permettre de surmonter ce moment difficile). Ne saisissez jamais l’animal par ses nageoires ou par la queue ; poussez sue les flancs ou à la base de l’aileron dorsale.(f) Si le cétacé persiste à retourner vers le rivage, ou s’il paraît incapable de nager malgré tous vos efforts, la tentative de renflouage est dévouée à l’échec et doit être abandonnée. Disposez l’animal sur la plage de la façon la plus confortable possible. (g) Ne tentez jamais de tuer l’animal pour abréger ses souffrances. Seul un expert peut réaliser cette opération : l’anatomie et la physiologie d’un cétacé différent notablement de celles des mammifères terrestres. Vous risqueriez d’accroître encore le supplice de l’animal en ne trouvant pas directement ses organes vitaux. Résistez à la tentation de l’exécuter par balles _ ces dernières seraient très probablement déviées par la forme du crâne et elles pourraient ressortir du corps et blesser des spectateurs. Toutefois, essayez d’accepter la situation si un expert décide que l’exécution est la seule issue envisageable. Simplement, il n’est pas possible de sauver chaque animal en difficulté et, dans tous les cas, les souffrances doivent être abrégées. 5. Alors qu’un cétacé solitaire est souvent trop faible ou trop malade pour nager, il est vraisemblable que la grande majorité des membres d’un groupe d’animaux échoués seront en bonne santé et renflouages (s’ils ne sont pas trop lourds à manipuler). Mais attention : les liens sociaux unissent toutes ces créatures sont extrêmement solides. Forcer un ou deux individus à s’écarter du rivage alors que leurs congénères sont encore sur le sable risque de devenir une opération particulièrement difficile. Le nombre de spécimens échoués pose également des problèmes. La situation impose la création d’équipes nombreuses, bien organisées, travaillant sous la direction _ même à distance, par téléphone _ d’experts familiers avec les structures sociales de l’espèce impliquée. Des équipements de levage et leurs manipulation habituels vous seront d’un secours inappréciable s’il vous est loisible de fabriquer rapidement des ventrières capables de supporter la masse des animaux et suffisamment rigides pour ne pas écraser les corps pendant leur transport. La meilleure stratégie à adopter en cas d’échouage collectif semble être la suivante : (a) Évaluez les ressources en termes de sauveteurs et d’équipements disponibles. Déployez le matériel et organisez des équipes aux tâches bien définies, dirigées par les leaders compétents. Assurez les communications entre les différentes équipes et le « maître de plage ». Constituez des groupes de relève et prévoyez le déploiement de nouvelles équipes et d’équipements supplémentaire. (b) Tentez d’empêcher les animaux encore dans l’eau de s’échouer à leur tour _ non pas en gesticulant ou en menant grand tapage, mais en regroupant (avec l’aide de personnes ou de bateaux) ces créatures dans un endroit peu profond et abrité. (c) Remettez à l’eau les animaux échoués auprès de leurs congénères encore à flot. (d) Guidez le groupe au complet vers le large.(e) C’est plus vite dit que fait ! Toutefois, les grands rassemblements de cétacés se composent souvent de sous-groupes plus restreints, dont les membres sont unis par des liens sociaux très solides. S’ils peuvent être identifiés chacun de ces sous-groupes sera traité à son tour, en commençant par celui qui renferme les animaux les moins touchés et plus faciles à manipuler. Si le mâle dominant est isolé (en cas de doute, essayez le spécimen le plus massif) et ensuite mis en sécurité, ses congénères (et ses subordonnés) suivront parfois le mouvement. Si nécessaire, empêchez ces « leaders » de retourner vers le rivage en les attachant avec précaution à une embarcation et assurez-vous que leur évent est continuellement émergé. Ne tirez jamais un cétacé par la queue : son évent se retrouvera sous l’eau et l’animal se noiera. La plupart des sons émis par ces créatures constituent des faisceaux acoustiques très étroits. Un leader doit être transporté à l’eau de façon à ce que sa tête reste toujours face au rivage, permettant ainsi à ses subordonnés encore échoués de continuer à entendre ses signaux. (f) En attendant d’être renfloués, les animaux échoués requièrent toute votre attention _ la priorité allant à ceux susceptibles d’être sauvés. On dit souvent que l’exécution des spécimens impossibles à manipuler facilite le retour à l’eau des autres. Cette option est à rejeter, à moins qu’un expert soit sur place. (g) Les difficultés suscitée par un échouage collectif ne doivent pas faire oublier l’acquisition d’un maximum de données concernant les animaux reposant sur le rivage. N’omettez pas de dénombrer les spécimens, ni de préciser leur position. Tentez également de réaliser un compte rendu aussi clair que possible de l’évènement, en spécifiant l’ordre d’arrivée des différents membres du groupe en difficulté. Cette information contribue à l’identification des sous-groupes et de leur leader. Notons que très peu de comptes rendus d’échouages collectifs nous sont parvenus, probablement parce que toutes les personnes présentes s’efforçaient d’aider les animaux. Pourtant, si nous connaissions les prémices de ces incidents, nous pourrions y découvrir des facteurs susceptibles de redresser le cours des événements. La presse et les autres média sont ici particulièrement utiles, si vous expliquez aux journalistes le genre de renseignements que vous désirez. |