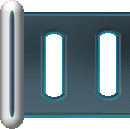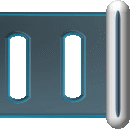|
La facilité avec laquelle les dauphins s’accommodent de la vie en captivité a permis d’aborder des recherches qui eussent été irréalisables sur des animaux en liberté. Plusieurs Delphinidés collaborent ainsi (car il s’agit bien d’une véritable collaboration) avec les scientifiques et les dresseurs. Le plus notable est le Tursiops, à tel point que le mot « dauphin » évoque maintenant, pour le grand public, la gracieuse silhouette de ce très sympathique animal. C’est lui que l’on voit le plus souvent évoluer dans les « marinelands » et océanariums, où il remporte toujours un grand succès auprès des spectateurs, qui admirent la facilité avec laquelle il exécute des exercices variés :sauter à travers un cerceau, saisir délicatement un poisson que le dresseur tient entre ses dent, jouer avec un ballon ou des objets divers, etc. Mais on peut aussi citer, parmi les odontocètes devenus familiers, le globicéphale, le faux épaulard, le Stenella, le Grampus ( ou dauphin de Risso), le Steno, le béluga, un Lagenorhynchus, et même l’épaulard, qui a montré en captivité des mœurs en contradiction avec sa réputation de tueur impitoyable. Depuis des dizaines d’années, de nombreux travaux sont consacrés à l’anatomie, la physiologie, la biologie générales, etc., des Delphinidés, et particulièrement des Tursiops. Les nations les plus actives en ce domaine sont les États-Unis, l’U.R.S.S., et le Japon. En France, il faut signaler le laboratoire de l’I.N.R.A, dirigé par le professeur R.G Busnel. On ne peut que résumer ici les résultats déjà acquis, résultats fort intéressants, certes, mais qui n’ont pas encore abouti à la solution de tous les problèmes posés par les Cétacés en général, et les Odontocètes en particulier. Il faut en outre tenir compte du fait que le comportement d’un Cétacé en captivité peut différer sensiblement de celui du même animal dans son milieu naturel. Les dauphins ont toujours manifesté une tendance à rechercher les contacts avec l’homme. Les mythes grecs en sont la première indication. Aussi ne faut-il pas s’étonner de la facilité avec laquelle les dresseurs arrivent à enseigner aux dauphins des exercices parfois fort compliqués, qui révèlent chez ces Cétacés intelligence et mémoire. Le terrain est d’ailleurs fort bien préparé : il est dans la nature des dauphins en liberté de jouer avec des objets flottants qu’ils ont l’habitude de pousser du museau devant eux ; et c’est là sans doute l’origine de leur réputation de sauveteurs bénévoles. Ils semblent par ailleurs éprouver un grand plaisir à apprendre et répéter les tours d’adresse qui font l’étonnement et l’admiration du public. C’est là le côté spectaculaire des dauphins. Mais les scientifiques, en collaboration étroite avec les dresseurs, sont allés beaucoup plus loin. Ils ont tout d’abord remarqué qu’un dauphin entraîné dans un aquarium pouvait être remis en pleine mer et conserver toutes les capacités acquises par le dressage : obéir au sifflet ou à la voix, et exécuter de véritables missions. Ainsi, lors de la mémorable expérience _ dites « Sealab » _ organisée par la marine américaine en 1965, un dauphin, nommé Tuffy, fut utilisé comme vaguemestre et agent de liaison entre les plongeurs, installés dans leurs maisons sous-marines, et la surface. De sont côtés, le professeur Perry W. Gilbert poursuit de très intéressantes expériences sur l’utilisation du Tursiops dans la lutte contre les requins. Au Mote Marine Laboratory, un dauphin, Simo, a été progressivement dressé à chasser et attaquer un requin (en l’occurrence Carcharhinus milberti) ; sa manière de combattre est simple et efficace : il frappe violemment, avec son rostre, le ventre du squale, déterminant chez celui-ci de très graves lésions internes. Il n’est donc pas interdit de penser que l’on pourra un jour utiliser les dauphins comme chiens de garde dans les régions où la présence de requins constitue un danger non négligeable. L’étude de l’intelligence des dauphins, et en particulier des Tursiops, retient à la fois l’attention des anatomistes et des psycho physiologistes. Des comparaisons ont été établies entre le poids absolu du cerveau de différents Mammifères, ce qui n’a pas grand sens. Puis on a considéré le rapport « poids cerveau - poids total ». D’autres chercheurs préfèrent adopter la relation existant entre le poids du cerveau et la surface du corps de l’animal. Aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée des études actuellement en cours dans ce domaine. Certains auteurs admettent que le cerveau du Tursiops se situe entre celui de l’homme et celui du singe anthropoïde. Cependant, un observateur américain, Scott Carpenter, affirme qu’une jeune otarie californienne ( Zalophus californianus) est capable d’apprendre en quelques jours ce qu’un dauphin n’assimile qu’après plusieurs mois de dressage. Quoi qu’il en soit, il est évident que les dauphins possèdent un cerveau très développé, présentant de nombreuses circonvolutions, et les anatomistes sont d’accord pour reconnaître qu’il s’agit d’êtres intelligents. A toutes les énigmes qui viennent d’être rapidement passées en revue s’en ajoute une autre, restée jusqu’ici absolument sans réponse : comment les dauphins dorment t-ils ? Contrairement à ce passe chez l’homme, où la respiration est « automatique », celle des dauphins (et de tous les Cétacés) est volontaire et exige de la part de l’animal un effort conscient et permanent. Un dauphin placé sous l’influence d’un narcotique cesse de respirer et ne tarde pas à mourir. Cependant, on a maintes fois constaté que les dauphins présentent l’aspect d’un repos, d’une relaxation pouvant faire croire que l’animal dort. Ce n’est peut être qu’une sorte de demi-sommeil, ou un sommeil intermittent interrompu par de courtes périodes où l’animal prend sa respiration. En tout état de cause, le problème reste posé.
|