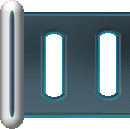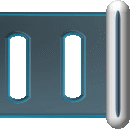|
Les relations homme-dauphin remontent à la plus haute Antiquité, et elles ont connu des fortunes diverses. Tout d’abord, les dauphins ont été considérés comme des amis de l’homme, recherchant sa compagnie, coopérant même avec lui et toujours prêts, le cas échéant, à lui porter secours et à l’aider dans ses activités maritimes. Pline l’Ancien était, en 70, collecteur d’impôts dans la Narbonnaise, et il écrivit que les dauphins avaient pour coutume de rabattre les mulets dans les filets des pêcheurs ; ceux-ci, en remerciement, offraient aux Cétacés « du pain trempé dans le vin ». Oppian cite un autre exemple de coopération sur les côtes d’Eubée. Encore de nos jours, sur les côtes d’Afrique et en Extrême-Orient, les dauphins sont, pour certaines populations de pêcheurs, de très utiles alliés qu’il convient de protéger, voire de vénérer et d’honorer. En revanche, en d’autres régions, les dauphins sont considérés comme nuisibles, détruisant de grandes quantités de poissons, causant de graves avaries aux filets. A tel point qu’en 1865 le 5ème arrondissement maritime (Toulon) édictait des mesures visant à combattre les petits Cétacés. Puis apparut, au début du présent siècle, le « béluga », nom sous lequel on désignait un animal inconnu des zoologistes, dont personne ne pouvait donner une description exacte, mais que l’on accusait de ravager les filets, de détruire les bancs de sardines, et que l’on rendait responsable de tout le désastre dont pouvaient être victimes les pêcheurs côtiers. L’Administration fut alors amenée à prescrire des mesures spectaculaires contre ce mystique « béluga » : emploi de fusils, de canons de 37,voire de 75,poison, inoculation de la rage, immenses barrages de filets, dirigeables (1912), avions, attribution de primes par tête d’animal capturé (25 franc-or), etc. Tout cela sans grand résultat. Il est certain que les engins de pêche étaient souvent endommagés ; mais les véritables coupables étaient fort difficiles à identifier : petits Cétacés, naturellement, mais aussi certains squales et chiens de mer. Quoi qu’il en soit, le terme même de « béluga » est maintenant tombé en désuétude dans cette acception et ne s’applique plus qu’au dauphin (Delphinapterusleucas), qui vit exclusivement dans l’Antarctique. L’unanimité n’était d’ailleurs pas absolue en ce qui concerne le caractère nuisible des petits Cétacés. En certains points de l’Atlantique, leur présence fait partie de ce que les pêcheurs appellent les « apparences », révélant la présence de bancs de poissons. Un échouement de Cétacés, grand ou petit, a toujours été considéré par les riverains comme une sorte de manne céleste, un apport de chair comestible et l’huile dont il était tiré tout le parti possible. Aussi au lieu d’attendre un échouement problématique et occasionnel, l’idée vint tout naturellement à l’esprit des marins d’aller chercher au large cette magnifique aubaine. C’est ainsi que s’est probablement établie l’industrie baleinière basque et, par le même processus, en différents points du monde, une exploitation des troupeaux de dauphins. Par exemple, dans le Pacifique, au sud-est des îles Salomon (Malaïta), un Stenella tient une grande place dans la vie des insulaires. Cette espèce, qui se rassemble parfois en troupes de cent à six cents adultes, est recherchée pour l’alimentation humaine et également parce que ses dents ont une valeur commerciale estimée à 5 cents pièce (on en fait des colliers valant jusqu’à 50 dollars). Plus près de nous, deux nations ont pratiqué la chasse systématique des Delphinidés, principalement les dauphins communs : l’U.R.S.S. et la Turquie, sur le littoral sud de la mer Noire. Celle-ci réalisait des captures considérables : de 3000 à 5000 t annuellement en moyenne, avec des pointes de 5000 à 8000 t ; le maximum de l’U.R.S.S. était de l’ordre de 3500 tonnes. On croyait ainsi atteindre un double but : produire de la chair comestible et détruire des animaux considérés comme prédateurs. C’était là une surexploitation qui n’a pas tardé à déterminer une baisse très rapide de la production. Puis, en 1966, le gouvernement soviétique, revenant sur l’idée préconçue des dauphins »nuisibles », a pris des mesures destinées à les protéger. En Norvège, les chasseurs de minke harponnent parfois des dauphins de grande taille : épaulards, hyperoodons, globicéphales ; mais il n’est pas question d’une exploitation systématique. D’ailleurs, un peu partout dans le monde, ces mêmes espèces et d’autres encore, comme le Berardius et le béluga, font partie du gibier occasionnel des chasseurs. Le béluga mérite cependant une mention spéciale : il faisait au Canada, l’objet étonnement précis, un véritable « sonar » qui leur permet de se diriger dans l’obscurité ou les eaux plus troubles, d’éviter les obstacles et même d’identifier leurs proies. Cette écholocation fait l’objet de recherches approfondies, qui sont loin d’être achevées. Les échouements de Cétacés sont attribués précisément au fait que leur « sonar » ne leur permet pas de détecter les plages ou grèves en pente très douce sur lesquelles leurs prétendus suicides ont toujours lieu. Il s’agit en somme d’accidents de navigation dus à l’absence d’écho. L’issue en est fatale dans la plupart des cas, surtout dans les mers à marées et lorsque l’échouement s’est produit au moment du plain. |